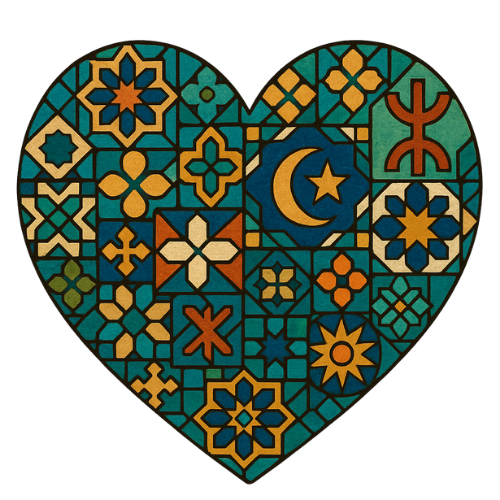L’Algérie a adopté en 1963 comme hymne national « Kassaman » (que l’on peut traduire par « Nous jurons ! »), chant emblématique de la lutte pour l’indépendance. Écrit pendant la guerre de libération par le poète nationaliste Moufdi Zakaria (1908-1977) et mis en musique par le compositeur égyptien Mohamed Fawzi, le texte de Kassaman célèbre le sacrifice et la détermination du peuple algérien.
L’hymne national algérien à la tonalité profondément combative a très vite cristallisé l’aspiration à la liberté ; il reste aujourd’hui un symbole majeur de la mémoire révolutionnaire algérienne. Ce contexte historique, le contenu des paroles et leur évolution post-indépendance forment le cœur de l’analyse qui suit, appuyée sur des sources académiques et historiques fiables.

Histoire de la création de L’hymne national algérien « Kassaman »
L’idée de Kassaman naît au sein du Front de libération nationale (FLN) à l’automne 1955, un an après le déclenchement de la révolution. Selon les historiens Larbi Zbiri et d’autres témoins, c’est le responsable FLN Abane Ramdane qui demanda à Moufdi Zakaria d’écrire un hymne national pour galvaniser la lutte contre le colonisateur.
Contrairement à certaines rumeurs, Zakaria n’a pas été « forcé », mais il répond à cette commande patriotique en composant l’un des poèmes les plus ardents de l’époque. Le poème original portait d’abord le titre Fašḥadū (« Témoignez-en ! »), comme l’atteste Larbi Zbiri, avant d’être rebaptisé Kassaman (« Nous jurons ») une fois l’indépendance acquise.
Le texte est rédigé en prison : Moufdi Zakaria est arrêté en avril 1955 et incarcéré à la prison Barberousse (Serkadji) à Alger. C’est là que, selon ses propres écrits, il compose Kassaman. Dans son recueil Al-Lahab Al-Moqaddass (Le Feu sacré), il déclare l’avoir « rédigé le 25 avril 1955 alors qu’il était dans sa cellule, dans la prison de Barberousse ». Privé de papier et de plume, il se serait même muni d’ustensiles rudimentaires pour graver ses vers sur les murs de la cellule.
Ces conditions extrêmement dures confèrent au poème une dimension légendaire. Kassaman compte cinq strophes, correspondant chacune à l’une des cinq Wilayas historiques de la révolution (Aurès, Nord-Constantinois, Kabylie, Algérois, Oranie) – la sixième Wilaya du Sud n’étant ajoutée qu’après août 1955. Le découpage en cinq couplets est encore symbolisé dans la musique : le compositeur final, Mohamed Fawzi, a intégré cinq coups de tambour initiaux pour représenter ces cinq régions historiques.
La musique de Kassaman fera l’objet de plusieurs tentatives avant d’être validée. Une première composition, par l’algérien Mohamed Touri, n’est pas retenue. Puis le Tunisien Mohamed Triki écrit une deuxième version en 1956, là encore non satisfaisante. Finalement, c’est le compositeur égyptien Mohamed Fawzi (aussi appelé Ahmed Fawzi) qui écrit la partition définitive à Tunis en 1957.
La version de Mohamed Fawzi est jugée « réussie » et devient l’accompagnement officiel de Kassaman, qui demeure jusqu’à aujourd’hui la musique de l’hymne national. Pour marquer la gloire de ce chant, on raconte qu’il remporte un premier prix lors d’un concours international du meilleur hymne – anecdote symbolique soulignant son rayonnement artistique.
Officiellement, Kassaman devient hymne national après l’indépendance. Bien que l’Indépendance soit proclamée le 5 juillet 1962, la loi ne fixe sa place qu’en septembre 1963. Les textes algériens formalisent alors son adoptionlemonde.frlepoint.fr. Le juge constitutionnel de 1963 inclut Kassaman parmi les symboles de l’État. Dès lors, il retentit lors des cérémonies patriotiques (5 juillet, 1er novembre…), à l’école et dans les événements officiels, marquant solennellement le nouvel État algérien.
Analyse approfondie du texte
Le texte de Kassaman est un appel solennel et martial. Le titre même signifie « Nous jurons », indiquant le caractère d’engagement total. Les paroles proclament un serment collectif de verser « le sang noble et pur généreusement versé » par les martyrs au service de la patrie. En ce sens, le poème inscrit le souvenir des victimes comme fondement identitaire : « Kassaman proclame en effet que l’appel de la patrie est écrit avec le sang des martyrs ». Cette image du sang versé rend explicite la notion de sacrifice nécessaire à la libération nationale.
Thématiquement, les cinq couplets alternent promesses de lutte et de victoire. Par exemple, le dernier vers de chaque strophe (« Soyez-en témoins ! ») sert de refrain solennel. Dans le troisième couplet, le ton se fait résolument revendicatif et anti-colonial. Le poème y interpelle directement la France coloniale : « Ô France ! Le temps des palabres est révolu. Nous l’avons clos comme on ferme un livre. Ô France ! Voici venu le jour où il te faut rendre des comptes ».
L’extrait « le temps des palabres est révolu… le jour où il te faut rendre des comptes » exprime clairement l’intention de ne plus transiger avec l’oppresseur. Le même couplet s’achève sur le triomphalisme révolutionnaire : « Nous avons décidé que l’Algérie vivra. Soyez-en témoins ! ». Ce dernier vers affirme en effet la détermination à reconstruire un pays libre.
Au-delà de ces passages explicites, le texte de Kassaman déploie un vocabulaire guerrier (« fulgurant », « martyrs », « sang… pur ») et héroïque (« flots d’une noble histoire », « terres parfumées de jasmins ») qui s’apparente aux traditions des hymnes révolutionnaires et patriotiques.
Plusieurs commentateurs relèvent qu’il n’est pas nécessairement plus « violent » que d’autres hymnes nationaux réclamant du sang. Par exemple, Le Point note que Kassaman « n’est pas plus violent que la Marseillaise et ses promesses de sang impur coulant dans les sillons », mais qu’il se distingue en nommant explicitement l’ennemi : la France. En somme, Kassaman emprunte la même rhétorique anti-coloniale que nombre de chants patriotiques, mais d’une manière frontale.
L’historien Sylvie L. (parfois cité) montre que le texte s’inscrit dans un long héritage anticolonial, tout en cherchant à forger une identité algérienne nouvelle.
Culturellement, Kassaman est perçu comme le miroir de la Révolution. Les symboles qu’il convoque — cri de ralliement, serment sur le drapeau, alliance du peuple et des combattants — font de ce chant un marqueur de cohésion nationale. Lors de la guerre d’indépendance, il renforçait l’unité des guerriers du FLN ; après 1962, il est enseigné comme le « souvenir vivant de la libération ».
Il a même été comparé à l’hymne national d’autres nations solidaires de la Révolution : par exemple, plusieurs sources soulignent que la musique de Kassaman évoque, par son style emphatique, des hymnes comme Fratelli d’Italia ou la Marseillaise, suggérant son caractère universel.
En revanche, dès l’indépendance, certains esprits suscitaient le débat quant au poids politique des paroles. L’évocation de la France a été jugée ambiguë : certains considèrent que nommer l’ex-colonisateur perpétue une dépendance symbolique, alors que d’autres y voient le rappel légitime du passé colonial. Cette tension culturelle se lit dans l’histoire de l’hymne (voir paragraphe suivant). Toutefois, pour la majorité des Algériens, Kassaman reste avant tout un hymne d’honneur et de mémoire.
Dans les enquêtes d’opinion, les citoyens interrogés confirment que Kassaman suscite un sentiment patriotique fort — certains confessent « avoir la chair de poule » ou pleurer en l’écoutant. L’hymne est d’ailleurs appris à l’école primaire et repris lors d’événements sportifs internationaux, marquant ainsi la fierté nationale. Le poète et commentateur Mabrouk souligne que contrairement à d’autres chants officiels, l’hymne algérien « fait ressentir ce que l’on a de plus intime, tiré de l’histoire douloureuse du pays », ce qui contribue à sa puissance émotionnelle.
Évolution depuis l’adoption officielle
Adopté peu après l’indépendance, Kassaman a été reconnu officiellement par la loi constitutionnelle dès 1963. Il remplace la Marseillaise de facto dans tous les cérémonials publics. Durant les premières décennies de la République, les cinq couplets étaient en principe chantés en entier dans les circonstances solennelles. Toutefois, l’hymne a fait l’objet de débats et de « versions » différentes selon les contextes.
Dans les années 1980, sous le président Chadli Bendjedid, un projet de réforme a suscité une controverse importante. Des proches du pouvoir estimaient que l’hymne national ne devait pas contenir de référence explicite à l’ancien colonisateur. Or, le troisième couplet de Kassaman cite nommément la France et parle de « rendre des comptes », ce qui choquait certains « vétérans du FLN » soucieux de dépasser la période coloniale.
Un projet de loi a donc été présenté pour supprimer purement et simplement ce couplet, la raison invoquée étant qu’aucun autre hymne national ne nomme un pays étranger. Finalement, cette proposition fut rejetée par les parlementaires (dont l’ancien moudjahid Mohand Belhadj, nostalgique du vers).
Un compromis a été trouvé en 1986 : la version intégrale de Kassaman (cinq couplets) serait réservée aux congrès du FLN et aux investitures présidentielles, alors que dans les autres cérémonies officielles, on ne chanterait plus que le premier couplet. Autrement dit, le passage contre la France était alors cantonné à des occasions très limitées. Cette règle a effectivement été gravée dans un décret présidentiel de 1986 (article 3).
Dès lors, les chefs d’État étrangers — français inclus — n’entendaient plus le couplet controversé lorsqu’ils assistaient aux cérémonies officielles. Cette pratique a perduré pendant des décennies, montrant le poids du compromis politique : la République maintenait l’intégralité de son hymne dans les textes de loi, tout en atténuant son message dans la pratique diplomatique.
En mai 2023, le président Abdelmadjid Tebboune a pris un décret élargissant les occasions où l’hymne intégral doit être joué. Conformément à ce décret, Kassaman doit désormais être interprété dans son intégralité lors de toutes les commémorations officielles en présence du Président. Autrement dit, le fameux couplet contre la France (citant « le temps des palabres est révolu ») réintègre le protocole national dans les cérémonies patriotiques.
Seuls certains événements diplomatiques de visites d’État à l’étranger pourront encore limiter la prestation à une version abrégée. Le pouvoir algérien justifie cette mesure comme un retour à la tradition révolutionnaire et un retour aux paroles « inscrites dans la loi », tandis que certains observateurs français y voient une instrumentalisation du nationalisme à des fins politiques contemporaines.
En dépit de ces polémiques sur le protocole, le texte même de Kassaman n’a pas fondamentalement changé depuis 1963 : aucun mot n’a été censuré ou modifié par la loi. C’est donc un hymne au contenu ferme et persistant qui perdure jusqu’à nos jours. Il reste la signature quasi sacrée de la Révolution algérienne, entonné avec respect lors de chaque grande fête nationale, des Jeux méditerranéens aux matchs de football, en passant par les commémorations de la guerre.
Anecdotes et faits historiques
De nombreuses anecdotes entourent l’écriture et la diffusion de Kassaman. Le plus célèbre est la légende du « mur sanglant » : on raconte que, n’ayant pas de papier, Zakaria aurait griffonné ses vers sur la pierre de la cellule avec son propre sang. Si cette image demeure populaire, les historiens notent qu’au minimum il rédigea ses poèmes dans des conditions de captivité extrêmes, souvent à l’aide de charbon ou de la sueur de sa main, faute de moyens plus nobles. Ce contexte dramatique a contribué à la puissance évocatrice du texte.
L’hymne fit également l’objet d’efforts de la part des autorités coloniales pour le supprimer. Les responsables français de l’époque cherchaient à étouffer toute expression patriotique ; chanter Kassaman lors des manifestations clandestines était passible de poursuites. À la libération, l’impact émotionnel de l’hymne sur la population était déjà reconnu : certains anciens combattants racontent encore avoir frissonné aux premières notes lors de la proclamation de l’indépendance.
Après l’indépendance, plusieurs anecdotes illustrent son rayonnement. Par exemple, le livre L’historique de l’épopée du chant Qassamen rapporte que Kassaman remporte un concours international d’hymnes, preuve de sa qualité littéraire et musicale. Le chant est également populaire dans la diaspora algérienne : on rapporte que des récitals de Kassaman dans les colonies des années 1960 à 1980 soulevaient souvent des larmes d’émotion.
Enfin, des faits contemporains montrent l’importance de ce symbole : par exemple, certains anciens généraux et officiels algériens ont publiquement salué la réintégration complète du texte, voyant là un geste fort envers les moudjahidine. En France aussi, l’hymne a été brièvement connu du grand public en raison des débats autour du couplet anti-français, suscitant à chaque fois un regain d’attention médiatique. Toutes ces anecdotes soulignent que Kassaman n’est pas qu’une simple mélodie officielle, mais un chant chargé d’histoire qui vit encore dans le cœur des Algériens.
Conclusion
En définitive, Kassaman reste un hymne national à la fois historique et chargé de sens. Né dans la tourmente de la guerre d’indépendance et façonné par un poète prisonnier, il exprime avec force la ferveur révolutionnaire et la volonté de libération du peuple algérien. Son texte, parsemé de symboles – le serment solennel, le sang des martyrs, l’appel au combat – cristallise l’identité algérienne née de la Révolution.
Depuis 1963, Kassaman a traversé les controverses politiques sans perdre son intégrité, réaffirmant par ses couplets l’ancrage anticolonial de l’Algérie tout en continuant de rassembler lors des grandes célébrations nationales. Ainsi, plus qu’un chant officiel, Kassaman est à la fois un patrimoine poétique et un acte de mémoire : il rappelle à chaque génération les sacrifices passés et l’engagement de garder la liberté conquise.